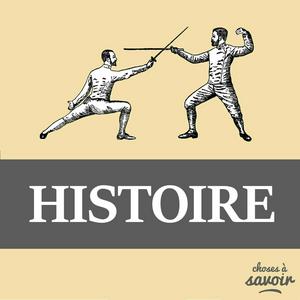Pourquoi les Vikings ont-ils abandonné le Groenland ?
Pour écouter mon podcast Le fil IA:Apple Podcast:https://podcasts.apple.com/fr/podcast/le-fil-ia/id1797244733Spotify:https://open.spotify.com/show/7DLZgY60IARypRmVGAlBM0?si=bacee66244884d27-----------------------------À la fin du Xe siècle, des colons vikings venus d’Islande, menés par Érik le Rouge, s’installent sur la côte sud-ouest du Groenland. Pendant plusieurs siècles, ils y vivent, élèvent du bétail, bâtissent des églises, commercent avec l’Europe… puis, au XVe siècle, ils disparaissent. Mais pourquoi ? Pourquoi ces colonies scandinaves ont-elles été abandonnées ?Plusieurs facteurs, combinés, expliquent ce retrait.D’abord, le climat. Au moment de l’installation des Vikings, l’Atlantique Nord connaît un réchauffement appelé l’optimum climatique médiéval. Les températures sont relativement clémentes, permettant la culture de l’orge et l’élevage de vaches et de moutons. Mais à partir du XIIIe siècle, le climat change. Un épisode plus froid et humide s’installe : c’est le début du petit âge glaciaire. Les hivers deviennent plus longs, les mers se couvrent de glace, et les pâturages disparaissent sous le pergélisol. Les rendements agricoles chutent, et la population commence à souffrir de malnutrition.Ensuite, l’isolement croissant. Le Groenland viking dépendait des échanges avec la Norvège pour obtenir du fer, du bois, du goudron et d’autres produits essentiels. Or, au XIVe siècle, les expéditions deviennent plus rares, en partie à cause du refroidissement des mers, mais aussi à cause de crises politiques et économiques en Europe. La peste noire, qui frappe le continent à partir de 1347, affaiblit davantage les réseaux commerciaux.Le commerce du morse joue également un rôle. Les Vikings exportaient de l’ivoire de morse vers l’Europe, où il était très recherché pour la sculpture. Mais à partir du XIIIe siècle, l’ivoire africain devient plus accessible et moins cher. Le produit vedette des Groenlandais perd de sa valeur, affaiblissant l’économie locale.La rigidité culturelle a aussi pesé. Les colons groenlandais ont tenté de reproduire leur mode de vie européen dans un environnement beaucoup plus rude. Ils ont préféré garder leurs habitudes d’élevage plutôt que de s’adapter à un régime plus marin, comme le faisaient les Inuits, pourtant bien mieux adaptés à l’environnement local. Il n’y a aucune trace d’assimilation ni de coopération durable entre Vikings et Inuits.Finalement, les dernières traces écrites datent du début des années 1400. Les églises sont abandonnées, les maisons vides, les ossements montrent des signes de famine.En somme, le départ des Vikings du Groenland n’est pas dû à une seule cause spectaculaire, mais à une lente agonie, faite de climat de plus en plus rude, d’isolement économique, de rigidité culturelle… et peut-être, d’un dernier bateau qui n’est jamais revenu. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.